Auguste Piccard,
Brillant savant et génial
inventeur, il a passé sa vie à poursuivre sa vocation de physicien,
d'aéronaute et d'explorateur des abysses.
Le grand-père au prénom d'empereur fit de sa vie une inlassable conquête
scientifique. En fait, le monde entier connaît Auguste, puisqu'il fut
immortalisé sous les traits du Pr Tournesol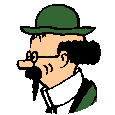 .
Hergé l'admirait pour ses capacités intellectuelles et sa physionomie: «Il
était très grand. J'ai donc fait un mini-Piccard, sans quoi j'aurais dû
agrandir les cases des dessins.» Le créateur de Tintin a habité le même
quartier bruxellois que son modèle, mais, par timidité excessive, n'a jamais
osé l'aborder dans la rue... Autant praticien que théoricien, Auguste Piccard
était bien Tryphon Tournesol: la tête et les jambes, un génial inventeur qui
concevait et construisait ses propres engins. Il avait l'air «illuminé» avec
ses petites lunettes rondes à deux verres superposés et une montre à chaque
poignet. «Auguste était un ambidextre original, qui dessinait des deux mains
pour la plus grande joie de ses étudiants», rapporte Yves Paccalet, qui lui a
consacré une biographie. Il en avait aussi l'inconscience, ce qui l'a poussé
à risquer sa propre vie pour tester ses inventions. Son itinéraire mérite
d'être retracé à la lumière de l'exploit de son petit-fils.
.
Hergé l'admirait pour ses capacités intellectuelles et sa physionomie: «Il
était très grand. J'ai donc fait un mini-Piccard, sans quoi j'aurais dû
agrandir les cases des dessins.» Le créateur de Tintin a habité le même
quartier bruxellois que son modèle, mais, par timidité excessive, n'a jamais
osé l'aborder dans la rue... Autant praticien que théoricien, Auguste Piccard
était bien Tryphon Tournesol: la tête et les jambes, un génial inventeur qui
concevait et construisait ses propres engins. Il avait l'air «illuminé» avec
ses petites lunettes rondes à deux verres superposés et une montre à chaque
poignet. «Auguste était un ambidextre original, qui dessinait des deux mains
pour la plus grande joie de ses étudiants», rapporte Yves Paccalet, qui lui a
consacré une biographie. Il en avait aussi l'inconscience, ce qui l'a poussé
à risquer sa propre vie pour tester ses inventions. Son itinéraire mérite
d'être retracé à la lumière de l'exploit de son petit-fils.
Auguste Piccard est un papillon enthousiaste, iconoclaste et dénué d'a priori.
Physicien, docteur des sciences naturelles, professeur à l'Ecole polytechnique
de Zurich, il s'intéresse à tout, avec quelques domaines de prédilection.
Depuis qu'il a assisté à Paris, en 1912, à la coupe Gordon-Bennett de ballons
libres, Auguste poursuit une double vocation de physicien et d'aéronaute. Il
n'aura de cesse de prendre  les
airs en motivant chacun de ses exploits par des expériences scientifiques :
«L'exploration est le sport des savants», aime-t-il répéter. Ainsi, le 20
juin 1926, lorsqu'il s'élève dans l'atmosphère de Bruxelles pour son premier
grand vol à 4 500 mètres d'altitude, c'est pour vérifier la théorie de la
relativité. La réussite de ce voyage lui apporte une certaine reconnaissance.
Piccard noue des liens étroits avec Albert Einstein, le Français Louis de
Broglie, l'Allemand Max Planck ou le Danois Niels Bohr.
les
airs en motivant chacun de ses exploits par des expériences scientifiques :
«L'exploration est le sport des savants», aime-t-il répéter. Ainsi, le 20
juin 1926, lorsqu'il s'élève dans l'atmosphère de Bruxelles pour son premier
grand vol à 4 500 mètres d'altitude, c'est pour vérifier la théorie de la
relativité. La réussite de ce voyage lui apporte une certaine reconnaissance.
Piccard noue des liens étroits avec Albert Einstein, le Français Louis de
Broglie, l'Allemand Max Planck ou le Danois Niels Bohr.
Au début des années 30,
celui que ses pairs surnomment «Décimale supérieure» n'a que faire de sa
notoriété naissante et caresse un rêve insensé : atteindre la stratosphère
en ballon pour y débusquer les secrets des rayons cosmiques. Alors que la mode
est aux avions, lui rêve d'altitude et voudrait s'élever du côté du royaume
des anges: à 16 000 mètres! Evidemment, son pari fou séduit, à commencer par
le souverain belge, qui lui accorde 57 000
francs-or par
l'intermédiaire d'un Fonds national pour la recherche scientifique. Rapidement,
le savant se met au travail et conçoit un engin démesuré (le volume de
l'enveloppe du ballon, en coton caoutchouté, atteint 14 130 m3). Piccard
résout le problème de la respiration en adoptant une cabine en aluminium
pressurisée (donc étanche) de 2,1 mètres de diamètre, pesant 1 tonne.
Là-haut, les risques sont innombrables et le professeur tente de les anticiper
: «Un danger prévu n'est plus un danger.» Parfois de façon sommaire, comme
lorsqu'il cherche à se protéger des secousses en confectionnant un casque: une
corbeille en osier rembourrée d'un coussin ! Le 27 mai 1931, le ballon, bardé
d'instruments (il s'agit d'abord d'une expérience scientifique) est fin prêt.
A 3 h, Auguste Piccard et son compagnon suisse, le physicien Paul Kipfer,
aperçoivent une cheminée : dans la hâte des préparatifs du départ, ils ne
se sont même pas aperçus du décollage. Dès lors, l'ascension se déroule
trop rapidement pour que les deux scientifiques aient le temps d'effectuer les
expériences. Au bout d'une demi-heure, les voilà sur le plafond du monde, à
15 781 mètres ! Dans le livre où il retrace son épopée, "Au-dessus des
nuages" (1933), le professeur raconte: «La beauté de ce ciel est ce que
j'ai vu de plus poignant ; il n'est plus d'azur, mais sombre, bleu foncé ou
plutôt violet, presque noir.»
Le sait-il vraiment ? Piccard est le premier homme dans l'espace. Une
prééminence que les scientifiques russes lui reconnaîtront lorsqu'en avril
1961 Youri Gagarine effectuera le premier vol spatial. Piccard reçoit un coup
de téléphone du président de l'Académie des sciences de l'Union soviétique
: «Le pionnier, c'est vous.»
Mais avant cela, il faudra redescendre. Le chemin du retour fut un calvaire.
Piccard et son coéquipier vont mettre une quinzaine d'heures pour retrouver le
plancher des vaches à cause d'une soupape bloquée qui les empêche de libérer
leur hydrogène. Surtout, ils ignorent l'endroit où ils pourront atterrir. Ce
fut le pire : les falaises, les pics et les crevasses du Tyrol autrichien... A
21 heures, soit dix-sept heures après leur décollage, le ballon s'immobilise
dans les montagnes, non sans heurts. Le «savanturier» vient de réaliser un
des plus beaux exploits du siècle. A son retour à Zurich, 20 000 personnes
l'accueillent. Il devient une star internationale.
Malgré son succès, Auguste Piccard constate au début de 1932 l'échec
scientifique du vol. D'où cette obsession : y retourner. Le 18 août, il
effectue une seconde ascension, sans encombre cette fois, qui permet de mesurer
l'intensité du rayonnement du sol à la stratosphère. Le défi scientifique
est gagné.
Bien que redescendu sur Terre, le savant est alors à l'apogée de sa carrière.
Il donne des conférences à travers l'Europe, rédige de nombreuses
publications où il met en avant le rôle de la couche d'ozone et séduit par sa
vision de l'espace. Dès 1933, il croit possible d'atteindre la Lune en fusée.
Une théorie qui fait sourire, mais il était au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale (Au seuil du cosmos», 1946). Ses travaux serviront notamment la
science-fiction et la bande dessinée, puisque Hergé s'en est largement
inspiré pour rédiger "Objectif Lune" et "On a marché sur la
Lune".
Le «savanturier» est un homme d'extrêmes : après le très-haut, le voilà
qui s'attaque au très-bas en voulant créer un appareil d'exploration
sous-marine. Dès 1948, il conçoit son nouvel engin, qu'il nomme
«bathyscaphe». La plongée inaugurale s'effectue au large du cap Vert, le 28
octobre 1948, en compagnie de Théodore Monod. Ce nouveau projet, une fois
encore financé par les Belges, fut cependant un échec cuisant. Au sortir de la
guerre, le paysage scientifique s'est profondément modifié pour se
mondialiser. Entouré de concurrents, Auguste Piccard va perdre la maîtrise de
son projet. La France remplace la Belgique et cherche à s'approprier la
paternité du «bathyscaphe». Le scientifique ne peut lutter, l'esprit
chevaleresque du «héros authentique» n'est plus de mise. Il y croit une fois
encore lorsque son fils lui propose de mener son propre projet à terme, à
l'aide d'une équipe italienne.
Jacques, le Piccard de deuxième génération, est un géant de près de 2
mètres, comme son père, mais doué d'un plus grand sens du concret et d'un
vrai talent de diplomate. Il a choisi les sciences humaines, étudie la
sociologie et part à Trieste pour une thèse sur le développement de cette
cité à la frontière de l'est et de l'ouest de la Méditerranée. Le hasard
s'en mêle. Le directeur du musée d'histoire de la ville, Diego de Henriquez,
s'enthousiasme pour le projet du «bathyscaphe». L'aventure repart sous les
couleurs italiennes. Le Trieste va battre un premier record de 3 150 mètres au
large de Capri, avec, à bord, Auguste, le savant, et Jacques, devenu expert en
pilotage. Désormais, c'est lui qui sera aux commandes de cet appareil très
délicat à conduire à la descente et, encore plus, à la remontée. Au côté
de son père, il apprend tout de la physique de l'atmosphère et des océans,
s'initie à toutes les technologies nécessaires à l'amélioration du
bathyscaphe.
Après les Italiens, ce sont les Américains qui s'intéressent au sous-marin
géant. Mais, à 70 ans, Auguste estime qu'il est trop âgé et passe la main à
son fils. On est, alors, en pleine guerre froide. En 1960, l'US Navy envoie
l'océanographe Don Walsh plonger avec Jacques Piccard dans la fosse des
Mariannes, la plus profonde, au milieu du Pacifique. Nouveau record battu : 10
916 mètres. Personne ne l'égalera jamais. Une descente angoissante, dans le
noir des abysses, à peine éclairé par le plancton luminescent jusqu'à 2 000
mètres, avec la crainte de s'engluer, tout en bas, dans un magma semi-liquide
dont le bathyscaphe ne pourrait pas se dégager. L'exploit est inouï et vaut à
Jacques la célébrité internationale à 38 ans.
Mais la marine américaine abandonne les recherches sur les grands fonds marins.
Jacques repart en Suisse, influence nombre de jeunes océanographes, imagine des
cabines en titane ou en aluminium, pense avec son père à une coque inspirée
de la peau des dauphins, met au point des engins plus modestes pour explorer le
plateau continental des océans. Dans le Benjamin-Franklin, Jacques se laisse
dériver pendant vingt jours pour étudier le Gulf Stream, ce mystérieux
courant atlantique qui réchauffe les côtes d'Europe. Finalement, il adopte la
passion de son père pour l'écologie et crée la Fondation pour l'étude de la
mer et des lacs, installée sur un promontoire au-dessus du Léman, face au mont
Blanc.
C'est dans ce paysage idyllique que grandit la tribu. Bertrand, le fils aîné
de Jacques (Thierry, son cadet, se consacre à la sculpture) a deux passions :
la médecine des âmes et les machines «plus légères que l'air». Il se
souvient des soirées en famille où passaient des physiciens et des
naturalistes, des marins et des explorateurs: «Il était normal pour moi de
tenter, à mon tour, une aventure», déclarait-il à L'Express avant son
départ dans Breitling Orbiter III. ULM, puis parachute, parapente, deltaplane,
le jeune psychiatre tâte de toutes les disciplines de vol libre, sans moteur.
Ce qui lui plaît dans les montgolfières ? Jouer avec les vents, s'allier
à eux, au lieu de les dominer et de les combattre, comme le font les pilotes
d'avion et les astronautes.
En 1992, Bertrand Piccard participe à la première grande course en
montgolfière à travers l'Atlantique, organisée pour célébrer l'anniversaire
de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Le spectacle est si beau
que l'idée d'un tour du monde s'impose. Sponsorisé par Breitling, l'un des
fabricants suisses de montres d'exception, il tente sa chance à trois reprises.
Comme son père et son grand-père, soutenu par la foi intense des protestants
vaudois, il surmonte les échecs qui ne sont pour lui que des péripéties
terrestres. Au premier essai, une fuite de kérosène l'oblige à faire amerrir
son ballon dans la Méditerranée. Lors du deuxième, interdit de survol de la
Chine, il atterrit en pleine campagne birmane, au milieu des paysans ébahis.
Malgré tout, il devient le recordman du vol le plus long. Comme sous son allure
charmante c'est un jeune homme très volontaire, il repart pour un troisième
tour. «Un exploit complet, explique Philippe de Saint- Sauveur, président de
l'Aéro-Club de France, sur les plans sportif, technique et humain.» Car il
fallait être acrobate pour se hisser sur le haut de la capsule pour dégager
les blocs de glace et vérifier les amarrages. Tenace comme les grands champions
pour dominer le froid et la fatigue. D'ailleurs, en bon psychothérapeute,
Piccard s'est exercé, avec Jones, à la sophrologie, une méthode de
relaxation. Mais il n'y a pas que les muscles, l'énergie et le psychisme dans
ce type de compétition. L'équipe joue un rôle essentiel. Or Bertrand, comme
son père, Jacques, possède un indéniable charisme, tout en conservant une
simplicité totale. Depuis le début, il a rendu hommage aux techniciens et aux
météorologues qui l'ont entouré, soutenu, guidé. Sans eux, impossible de
naviguer au milieu des caprices du jet-stream, d'échapper aux tempêtes, de
tracer la meilleure route afin d'éviter les zones interdites du centre de la
Chine.
Dernier élément du succès :
la technologie de la montgolfière. Le concepteur, Don Cameron, a mis au
point, à la demande de Piccard, un ballon à double paroi qui cumule les
avantages des deux traditions rivales, celle de l'air chaud et celle de
l'hélium. Il y a ajouté des panneaux solaires, qui ont permis de
substantielles économies d'énergie.
Dernier exploit du siècle, ce tour du monde permet aux Piccard de boucler la
boucle, à Bertrand de rendre hommage à son grand-père, Auguste, le savant.
«Je me suis senti guidé par une main invisible», déclare-t-il en arrivant en
Egypte. Etait-ce celle du fondateur de la dynastie ? En tout cas, les fans des
«plus légers que l'air» qui font voler leurs petites montgolfières, chaque
année, à la Saline royale d'Arc-et-Senans, dans le Doubs, voient en Bertrand
l'homme qui a réconcilié la science moderne avec la nature. Et fondé une
lignée de passionnés qui conjuguent science, conscience et aventure.
retour
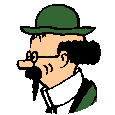 .
Hergé l'admirait pour ses capacités intellectuelles et sa physionomie: «Il
était très grand. J'ai donc fait un mini-Piccard, sans quoi j'aurais dû
agrandir les cases des dessins.» Le créateur de Tintin a habité le même
quartier bruxellois que son modèle, mais, par timidité excessive, n'a jamais
osé l'aborder dans la rue... Autant praticien que théoricien, Auguste Piccard
était bien Tryphon Tournesol: la tête et les jambes, un génial inventeur qui
concevait et construisait ses propres engins. Il avait l'air «illuminé» avec
ses petites lunettes rondes à deux verres superposés et une montre à chaque
poignet. «Auguste était un ambidextre original, qui dessinait des deux mains
pour la plus grande joie de ses étudiants», rapporte Yves Paccalet, qui lui a
consacré une biographie. Il en avait aussi l'inconscience, ce qui l'a poussé
à risquer sa propre vie pour tester ses inventions. Son itinéraire mérite
d'être retracé à la lumière de l'exploit de son petit-fils.
.
Hergé l'admirait pour ses capacités intellectuelles et sa physionomie: «Il
était très grand. J'ai donc fait un mini-Piccard, sans quoi j'aurais dû
agrandir les cases des dessins.» Le créateur de Tintin a habité le même
quartier bruxellois que son modèle, mais, par timidité excessive, n'a jamais
osé l'aborder dans la rue... Autant praticien que théoricien, Auguste Piccard
était bien Tryphon Tournesol: la tête et les jambes, un génial inventeur qui
concevait et construisait ses propres engins. Il avait l'air «illuminé» avec
ses petites lunettes rondes à deux verres superposés et une montre à chaque
poignet. «Auguste était un ambidextre original, qui dessinait des deux mains
pour la plus grande joie de ses étudiants», rapporte Yves Paccalet, qui lui a
consacré une biographie. Il en avait aussi l'inconscience, ce qui l'a poussé
à risquer sa propre vie pour tester ses inventions. Son itinéraire mérite
d'être retracé à la lumière de l'exploit de son petit-fils. les
airs en motivant chacun de ses exploits par des expériences scientifiques :
«L'exploration est le sport des savants», aime-t-il répéter. Ainsi, le 20
juin 1926, lorsqu'il s'élève dans l'atmosphère de Bruxelles pour son premier
grand vol à 4 500 mètres d'altitude, c'est pour vérifier la théorie de la
relativité. La réussite de ce voyage lui apporte une certaine reconnaissance.
Piccard noue des liens étroits avec Albert Einstein, le Français Louis de
Broglie, l'Allemand Max Planck ou le Danois Niels Bohr.
les
airs en motivant chacun de ses exploits par des expériences scientifiques :
«L'exploration est le sport des savants», aime-t-il répéter. Ainsi, le 20
juin 1926, lorsqu'il s'élève dans l'atmosphère de Bruxelles pour son premier
grand vol à 4 500 mètres d'altitude, c'est pour vérifier la théorie de la
relativité. La réussite de ce voyage lui apporte une certaine reconnaissance.
Piccard noue des liens étroits avec Albert Einstein, le Français Louis de
Broglie, l'Allemand Max Planck ou le Danois Niels Bohr.